Dossier
Technique N¡7
Mai 1998
Introduction
la colorimtrie (1re partie)
La
colorimtrie est la base de tous les systmes de reproduction d'images
existant tels que le film et la vido et probablement des systmes futurs. Elle
permet de qualifier d'une manire scientifique et rigoureuse la perception des
couleurs. C'est le passage oblig entre le monde artistique de la cration des
images et le spectateur, ds que celui-ci accde l'oeuvre par un moyen
technique de diffusion ou de reproduction.
La plupart
des travaux scientifiques de normalisation ont t mens par la CIE (Commission
Internationale de l'Eclairage). C'est une organisation indpendante ddie
l'tude de la lumire et de l'clairage. Ces recommandations font autorit en
la matire et la CIE est reconnue par l'ISO (International Standard
Organisation)
comme un
organisme international de standardisation.
Ce dossier,
ralis avec la collaboration de Franois Helt et Bernard Tichit, est la
synthse de la documentation runie au sein du Groupe de Travail CST
"Sensitomtrie et Traitement Numrique" et notamment
des exposs
de Jean-Fabien Dupont (Kodak) et Wilfrid Meffre (Theta Scan). Il a pour but de
prsenter les notions de base de la colorimtrie.
La sensibilit globale de l'oeil
L'oeil est
sensible aux radiations lumineuses dont la longueur d'onde est comprise entre
380 nm et 780 nm.
La figure 1
montre la courbe de sensibilit de l'oeil telle quelle a t normalise par la
CIE.
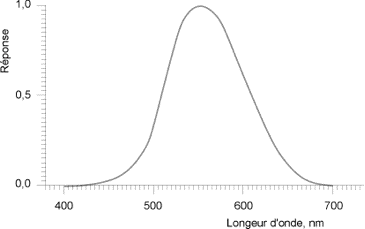
Figure 1
La sensibilit des cellules de la rtine
Physiquement,
mesurer une couleur, consiste dterminer l'aide d'un spectrophotomtre le
niveau d'nergie rayonne pour chaque longueur d'onde du spectre visible.
En pratique, 32 mesures, soit une tous
les 10 nm, sont suffisantes pour obtenir le spectre d'un rayonnement
lumineux. Toute la difficult consiste trouver l'quivalence entre le spectre
que l'on a mesur et la sensation colore qu'il provoque chez l'observateur. Un
calcul rapide montre
que l'on
peut mesurer 1064 spectres diffrents (32 mesures sur une chelle de 100
niveaux, soit 10032 = 1064).
C'est
videmment bien suprieur au nombre de couleurs que l'oeil peut distinguer. En
considrant que l'on peut distinguer un milliard de couleurs ( vrifier), il
reste 1055 spectres possibles pour produire chacune de ces impressions
colores.
Si on
considre la vision, la rtine comporte quatre types de cellule. Les btonnets qui
sont sensibles aux trs faibles lumires et trois types de cnes sensibles
principalement au rouge au vert et au bleu, si la quantit de lumire est
suffisante.
L'oeil a
donc deux fonctionnements diffrents selon la luminosit.
La vision
dite Scotopique, nocturne, dnue d'impression colore puisqu'un seul type de
cellule ragi aux stimulus.
La vision
Photopique, diurne, o les trois types de cne ragissent au stimulus et sont
l'origine de l'impression colore.

Figure 2 :
Sensibilit l'clairement des cnes et des btonnets.

Figure
3 : Sensibilit spectrale des cnes.
Il est
intressant de remarquer que si les cnes sensibles au bleu ont une courbe
spectrale bien distincte des autres, pour le rouge et le vert il y a un tel
recouvrement qu'il est impossible de les exciter sparment.
Ce
recouvrement contribue largement notre sensibilit la couleur. En effet,
partir du moment o une seule famille de cnes rpond aux stimuli, comme c'est
le cas aux extrmits du spectre visible, il n'est plus possible de percevoir
de diffrence de couleur.
La nature trichromatique de la
sensation colore et la synthse additive
Le
paragraphe prcdent montre que la sensation colore, qui intuitivement
comporte trois caractristiques, Luminosit, Teinte et Saturation, peut tre
exprime mathmatiquement par seulement trois valeurs puisque l'Ïil ne comporte
que trois types de photorcepteurs. La vision colore est par nature
trichromatique.
La
reproduction d'une couleur ne va donc pas s'attacher reproduire un spectre
lumineux identique en tous points celui d'origine mais utiliser trois
sources primaires, en gnral rouge verte et bleue, qui vont produire sur
l'oeil, les trois mmes stimuli que la couleur d'origine, c'est la synthse
additive, voir la figure 4.
La quantit de chaque primaire,
ncessaire pour galiser, c'est dire obtenir l'quivalent d'une sensation
colore donne, peut servir de mesure pour la qualifier.
L'ensemble
des spectres diffrents qui sont reprsents par les mmes quantits de
primaire sont appels mtamres.
Attention,
deux mtamres qui paraissent identiques sous un clairage donn apparatront
diffrents si les conditions d'observation changent (voir plus loin le ¤
Temprature de couleur).

Figure
4 : Equivalence visuelle entre une source lumineuse et le mlange de trois
primaires
Les lois de Grassmann
Ces lois
fondamentales rsument les proprits de la synthse additive et permettent de
nombreux calculs colorimtriques.
Elles sont
les suivantes :
Trois
variables indpendantes sont ncessaires pour spcifier une couleur,
Pour
un mlange additif de stimuli couleurs, seules les valeurs des primaires sont
considrer, pas les compositions spectrales,
Dans un mlange additif de
stimuli, si un ou plusieurs composants sont graduellement changs, les valeurs
rsultantes des primaires changent aussi graduellement.
Une
proprit importante de la vision, dcrite par l'exprience suivante, dcoule
de ces lois :
Prenons une
couleur C1 qui a pour quivalent visuel le mlange des trois primaires dans les
quantits R1, V1 et B1, et une couleur C2 quivalente la synthse R2, V2 et
B2. La somme des deux flux lumineux C1+ C2 a pour quivalent visuel la somme
des composantes soit R1 + R2, V1 + V2 et B1 + B2. Ce phnomne est connu sous
le nom de loi de Grassmann.
La temprature de couleur d'une source
lumineuse
La couleur
des objets est fortement influence par la lumire qui les claire. Cela impose
de qualifier les sources de lumire utilises si on veut pouvoir comparer des
chantillons colors. En gnral, la lumire artificielle est produite en
chauffant un filament mtallique.
Plus la temprature augmente, plus
l'activit molculaire augmente,
produisant
une mission lectromagntique de plus en plus puissante. Le physicien
allemand, Max Planck, a dmontr que le spectre lumineux mis par un corps noir
parfait, totalement absorbant, dpend uniquement de sa temprature. La figure 5
montre les spectres obtenus pour diffrentes tempratures du corps noir,
exprimes en degr Kelvin.
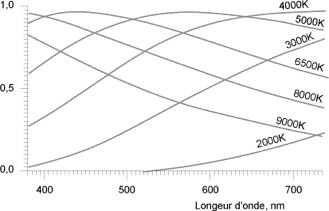
Figure 5
Cela permet
de qualifier une source de lumire par la temprature du corps noir produisant
un rayonnement quivalent. Dans le cas des lampes incandescence,
l'quivalence est trs facile trouver, car le spectre d'un filament est trs
proche de celui du corps noir.
Pour les sources qui utilisent une
dcharge lectrique dans un gaz, comme les tubes fluorescents, le spectre
comporte des raies importantes et la corrlation avec l'mission du corps
noir est
presque impossible trouver. Dans ce cas, on donne une temprature de couleur
indicative qui correspond une sensation quivalente pour l'oeil.
La lumire
du jour constitue un cas particulier, en effet elle varie normment en
fonction de l'heure et des conditions climatiques. La rpartition spectrale de
la lumire solaire, une fois filtre par l'atmosphre, est trs diffrente du
rayonnement du corps noir
La CIE a
normalis plusieurs illuminants qui ne sont pas des sources de lumire relles
mais des courbes de rayonnement spectral, en voici quelques uns : (voir la
figure 6).
Illuminant
A : La lumire du corps noir 2856 ¡K.
Illuminant
C : Lumire du jour moyen avec une temprature de couleur quivalente
6774 ¡K environ.
Illuminant
D65 : Reprsente un tat de la lumire du jour avec une temprature de
couleur quivalente 6504 ¡K environ. C'est l'illuminant de rfrence de
la vido.

Figure 6
Dans
certains cas, on peut utiliser le concept de l'illuminant d'gale nergie E,
qui prsente un spectre d'mission plat, mme niveau toutes les longueurs
d'ondes.
Pour
l'illuminant A, il existe une source relle ayant le spectre normalis mais
pour le D65 la CIE n'a trouv ce jour aucune source correspondante.
Dans la
2me partie nous voquerons l'Observateur de Rfrence de la CIE qui dfinit le
comportement moyen de
l'oeil,
ainsi que les principaux espaces gomtriques de reprsentation des couleurs.
En
attendant, ou pour en savoir plus, voici une liste d'ouvrage sur le
sujet :
Bibliographie (consultable la CST) :
Norme CIE/ISO 10527 : Observateur de rfrence colorimtrique CIE
CIE : Technical Report - Colorimetry second edition
Charles Poynton :
A Technical Introduction to Digital Video
Wide Gammut Device-Independent Colour Image Interchange
Frequently asked question about Colour
Siggraph 97 : Course Notes - Scanning and Recording of motion
Picture Film
IBA : Technical Review - Light and Colour Principles
NAB 95 : Pixels, Pictures and Perception
A. Pouyferri : ORTF, Service des Etudes - Colorimtrie
L. Goussot : Ecole Suprieure d'Electricit - Photomtrie et
Colorimtrie
Charles Poynton : Color technology, Color links
Rdaction :
Matthieu Sintas
©1998, Commission Suprieure Technique de l'Image et du Son